Utopie
et Voyage imaginaire chez les romantiques
L’homme est, de par
sa nature, un être voyageur. Les mythes anthropogoniques nous le dépeignent
avec une palette de couleur où l’errance est décrite comme un déterminant de la
nature humaine, voire comme une nécessité que tout être humain ressent du moment
où il s’apprête, qu’il le veuille ou non, c’est-à-dire consciemment où
inconsciemment, à transcender les limites du premier territoire où il se sent à
jamais incarcéré (Samuel Rouvillois). En d’autres termes, l’homme est, de par
son essence, un être dont le drame viatique intérieur peut être résumé en cette
insoluble équation qui réside dans l’acharnement avec lequel il s’escrime,
vaille que vaille, à franchir les frontières dessinées par sa dimension
corporelle pour s’infiltrer dans des univers jusqu’alors impénétrables.
Outre le rêve, l’imagination est
l’arme la plus puissante dont la nature ait muni ou nanti l’être humain. Si le
rêve est communément défini comme cette propriété que possède l’âme humaine,
laquelle lui permet de déborder le corps où elle est écrouée, pour se livrer à
un jeu d’emblée frugalement insignifiant mais psychanalytiquement décryptable
et là où entre en jeu la mnëmê, qui désigne, selon les mots de Paul Ricœur, la
mémoire en tant qu’affection ou en tant que pathos dont la venue à l’esprit est
hypnotique, non pas dans le sens de narcotique mais dans le sens
d’involontaire, l’imagination peut être alors définie comme une activité
qu’Edmond Husserl, en bon phénoménologue, qualifierait d’intentionnelle, eu
égard au fait qu’elle est intentionnalisée par le Sujet, mais aussi volontaire
parce qu’elle recourt, entre autres moyens proprement psychologiques, à l’anamnësis
comme objet d'une quête ordinairement
dénommée rappel, recollection, selon P. Ricœur toujours.
Par conséquent, l’écriture, fruit de
l’esprit humain, n’est au fond qu’un voyage dans et par les signes, dira plus
lucidement Michel Butor. Dans La nausée de Jean-Paul Sartre, nous lisons la
phrase suivante : « Les Voyages sont la meilleure école ». S’il
le dit par la bouche d’Antoine Roquentin, c’est qu’il est conscient que la vie
sans voyage et sans écriture n’aurait absolument aucun sens. Non seulement le
voyage est d’une valeur instructive ou heuristique d’investigation d’espaces
vierges ou dont l’esprit n’avait aucune représentation, mais aussi une source
d’inspiration prolifique qui éperonne les artistes à une réappropriation
démiurgique d’une réalité tout autre. Les analyses syntagmatique et
paradigmatique de la relation transactionnelle entre l’écriture et le voyage
nous ont dicté respectivement deux pistes de réflexion : la première
concerne l’écriture du voyage comme transcription d’une expérience réelle et la
seconde porte sur le voyage à travers l’écriture, c’est-à-dire l’écriture comme
un lieu d’errance utopique pour reprendre les termes d’A. Laâbi.
Si le XVIIIème
siècle fût imprégné par la tendance positiviste du voyage comme expédition
scientifique et où le voyageur s’arroge le statut de philosophe encyclopédiste
comme quelqu’un dont, au dire de Diderot, le jugement est formé et la tête
meublée de connaissances requises, deux conditions sine qua non
déterminantes du portrait du bon voyageur, le voyageur du XIXème est
sculpté comme un homme dont l’étendue de l’esprit, l’acuité de l’observation et
la multi-dimensionnalité des angles de vue sont les principaux traits de
caractère. Selon l’expression d’Eugène Fromentin, « le voyageur idéal
que nous rêvons ne devrait pas être un homme de génie et ne devrait pas
posséder des dons extraordinaires mais offrir un équilibre et, je répète le
mot, une moyenne de qualités opposées réunies dans une exacte
proportion ». A y voir clair, nous allons nous rendre compte que cette
définition prend de base la forme des piédestaux de la doctrine romantique
érigés par Shakespeare en Angleterre, Novalis, Kleist, Schiller et Goethe en
Allemagne, Chateaubriand, Lamartine et Hugo en France. Pour Fromentin, lors
d’un voyage, on exige du sérieux, mais trop de sérieux porte préjudice à
l’agrément du voyage. L’écrivain-voyageur doit être, à son sens, un rêveur,
parce que le rêve lui permet de saisir la beauté de l’espace qu’il sillonne.
Les romantiques allemands
C’est dans
ce contexte que s’inscrivent les productions artistiques du grand romantisme.
Certes, la thématique de l’errance est l’une des thématiques les plus
immémoriales de la littérature universelle, L’Odyssée est, en ce sens, le parangon
des récits de voyage, du voyage en tant qu’une aventure de l’écriture, en tant
qu’une rêverie d’un Eldorado, ou en tant qu’un périple effectif, pour utiliser
une terminologie proprement rousseauiste, mais, elle se fait récurrente chez
les romantiques à tel point qu’elle est devenue un leitmotiv, une obsession, un mythe tout court, menant
ainsi les écrivains par le bout du nez à une recréation incessante du réel et à
une réinvention continuelle des rapports qu’entretiennent le Moi et la Nature.
En effet, si d’André Chénier à Charles Baudelaire, la poésie fut le laboratoire
favori pour l’expression romantique, il convient, à mon sens, de mettre
l’accent sur le fait que le voyage, pris dans le sens large du terme, a ceci de
commun avec la poésie qu’il est une quête de l’inconnu, une exploration de
l’endogène par le langage, et une recréation d’univers totalement différents du
quotidien.
Chez les
romantiques allemands tout particulièrement, le thème de l’errance comme
exploration de l’intériorité par un sujet qui se sonde et qui cherche à
découvrir les couches les plus profondes de son Moi, revient avec une force
intransigeante. Imprégnés par Herder et Hölderlin, Beethoven et Wagner, les
poètes romantiques allemands entendaient en finir avec la philosophie des
lumières et avec l’Aujklärung. En guise d’exemple, le récit d’Eichendorff Les
Chevaliers de Fortune allie poétique et métaphysique pour exprimer
l’errance de l’homme condamné à vivre en vagabond dans des incertitudes
ontologiques rembourrées de mélancolie, et le narrateur-personnage semble
osciller à califourchon entre un nomadisme bohémien et un héroïsme pathétique,
pour ne pas dire tragique. Aux murmures dans les bois d’Eichendorff,
fait écho le Lenz de Büchner, lequel entame une excursion catabasique
qui prend fin par un suicide avorté. Il faut voir dans l’écriture erratique des
romantiques allemands l’empreinte d’un donquichottisme fantasque où ils se
plaisent à se prendre pour des chevaliers errants, cherchant à reconquérir on
ne sait quel idéal. Lisons ce quatrain des murmures dans les bois d’Eichendorff :
Au
terme de nos longs voyages
Nous verrons
sur les monts lointains
Luire à travers
les clairs nuages
La cité d’or et
ses jardins.
Voyons avec
quelle vision idyllique et édénique est perçu un ailleurs pastoral et
paradisiaque. La cité d’or ne traduit-elle pas l’univers utopique dont le poète
construit les contours au terme d’un long voyage imaginaire ? La meilleure
preuve qu’il s’agit là d’un voyage intérieur imaginaire nous est fournie ici
par l’absence de toute indication sur la destination du voyage. D’ailleurs, les
chants entonnés par ces écrivains se font encore plus retentissants lorsqu’ils
fusionnent au poétique ce qui est mystique, dans la mesure où ils s’évertuent
toujours à voyager dans le temps, un temps qui s’écoule, pour se donner et
prophétiser une image du futur. Force nous est de souligner que, dans le
sillage de la philosophie de Hegel, les écrivains romantiques s’attèlent,
chacun à sa manière, à concéder à l’errance humaine la fonction motrice de la
recherche de l’absolu. Somme toute, la conception du voyage chez ces
romantiques peut être résumée par ce récit dialogique de Ludwig Tieck intitulé Voyage dans le bleu
« Oh ! Frédéric, ce qui
m’attire c’est la solitude, cette douceur de ton que la forêt ou la montagne
prend pour nous parler, le secret qu’un ruisseau veut nous confier dans son
murmure. Et j’ai pu remarquer aussi, tout au long de notre voyage, que toi, tu
ne me comprends pas. »
« Non, dit Frédéric avec quelque
surprise, je ne te saisis vraiment pas. Nous allons tantôt à droite, tantôt à
gauche, nous passons la nuit à la belle étoile, tu escalades cette montagne ou
cette autre, tu n’es jamais content, tu n’aspires qu’à aller plus loin et tu te
fâches lorsque je veux te faire comprendre combien, finalement, il est
nécessaire que nous rebroussions chemin. »
C’est ainsi que pour les
romantiques, voyager dans l’imaginaire implique de déserter le « vrai
lieu » pour utiliser une formule proprement bonfoyenne. Le passage du monde
connu et réel au monde imaginaire et inconnu est concomitant, au niveau
sémiotique, de la transition d’un univers diurne à un univers nocturne, vu que
le noctambulisme incarne chez eux le mode de représentation du rêve. C’est
ainsi que le thème de la nuit, que l’on va retrouver chez Alfred de Vigny dans
son recueil Les Nuits, revient avec force dans l’écriture onirique romantique.
Les célèbres Hymnes à la nuit de Novalis en sont l’exemple le plus
révélateur.
A juste titre, les derniers
vers du cinquième Hymne nous font bien comprendre cette possibilité de
découvrir l’au-delà à travers l’écriture poétique :
Le
souvenir se fond dans le fleuve des ombres.
Ainsi la poésie
célébra notre triste redevance.
Mais
indéchiffré demeura le secret de l’éternelle
Nuit, Grave
avertissement d’une puissance lointaine.
Cette « puissance lointaine », symbolisée
par l’éternelle nuit, incarne le sort métaphysique mystérieux de l’homme sur
terre. Et c’est à la poésie de nous le révéler; elle nous enseigne la
fascination d’une recherche de l’homme originel à travers le langage. Tel fut
le sens, pour Hölderlin et pour l’ensemble du romantisme allemand, de
l’errance, au terme de laquelle — s’il y a un terme de quelque façon — il y a
la conscience ou le dieu.
Chateaubriand et l’itinéraire de
Paris à Jérusalem
La France, à cette
époque, n’était pas vraiment en total déphasage avec ce qui se passait en
Allemagne, comme le prétendaient certains critiques d’alors. A dire vrai, elle
aussi avait de quoi assouvir la curiosité de lecteurs avides de voyager dans et
par les mots. L’acte du baptême de l’écriture du voyage littéraire est conféré
par le Génie du siècle dont Hugo voulait être l’épigone à tout prix, celui dont
l’âme fût très tôt rongée et déchiquetée par le mal du siècle, et qui n’est
autre que Chateaubriand. Sous son égide, et à l’instar de Rousseau, Bernardin
de Saint-Pierre, Benjamin Constant et Mme de Staël, l’on verrait surgir à
l’aube du siècle toute une tendance d’écrivains corrodés par une angoisse
ontologique qui les bousculerait à s’exiler sur des terres lointaines pour
renouer avec leur Moi. En un mot, Chateaubriand fut, par excellence, l’étrenne
d’une praxis que l’on étiquetterait voyage littéraire par la suite.
Son Itinéraire
de Paris à Jérusalem représente, à plusieurs égards, le spécimen de la
démarche scripturale romantique, laquelle consiste à assigner au langage une
fonction proprioceptive, dans la mesure où celle-ci permet de superposer les
états de choses du monde extérieur de l’actant-perçu sur les états d’âme
intérieurs de l’actant-percevant. Cette fonction sémiotique qui se dessine au
croisement de l’intéroception du JE et de l’extéroception du Monde extérieur
est à l’œuvre chez les romantiques. En fait, Chateaubriand s’évertue tout au long
de son itinéraire à « rabattre les états de choses extérieurs sur ses
états d’âme intérieurs » pour reprendre Fontanille. C’est-à-dire que loin
de se borner à une description objective ethnologique des paysages qui
s’offrent à sa vue, l’auteur du Génie du christianisme essaie de sentir le
monde en soi, de se l’approprier, et de le soumettre à ce que Sainte-Beuve
appelait « le lyrisme intime », en s’investissant progressivement
dans l’énoncé littéraire dont il est le sujet de l’énonciation, lui qui affirme :
« Je parle éternellement de moi »
En termes plus
clairs, Chateaubriand projette un regard panoramique sur des espaces qui se
dessinent devant lui, s’escrimant ainsi à embrasser plutôt qu’à pénétrer
l’histoire des peuples et des civilisations. Certes, à ses yeux, le monde éclot
en largeur et « en surface », mais il ne se laisse pas aller jusqu’à
envelopper dans un logos objectif la description des espaces géographiques et des
espaces humains. C’est pourquoi, ses déplacements hèlent son esprit et convient
sa sensibilité à confronter son savoir livresque avec son vécu erratique. Dès
lors toute l’entreprise de Chateaubriand s’inscrit dans un cadre purement
cartésien, dans le sens où le motif du voyage se résume dans ce souci de confirmer
ou d’infirmer les incertitudes qui ensevelissent dans le scepticisme ce qu’il
avait déjà lu au sujet des contrées qu’il visite.
«
Un voyageur est une espèce d’historien : son devoir est de raconter
fidèlement ce qu’il a vu ou ce qu’il a entendu dire, il ne doit rien inventer,
mais aussi, il ne doit rien omettre »
« Je me suis aperçu [...] que la face
des objets a changé pour moi. Je sais ce que valent [...] ces rêveries de la
première jeunesse [...] » (It.
I, 153).
« En Grèce,
tout est suave, tout est adouci, tout est plein de calme dans la nature comme
dans les récits des anciens »
(It. 1, 157)
Voyons comment Chateaubriand s’attèle à exciser de son esprit les
images qui s’y sont construites sous l’impulsion de ses rêveries juvéniles,
mais aussi comment il s’efforce d’harmoniser ou de concilier le factuel avec le
livresque, et retenons, ici, cette image d’une Grèce édénique, où l’harmonie
des arts répond à celle de la nature.
Par ailleurs,
force nous est de mentionner que le tableau chateaubriandesque ne s’offre pas
d’un seul coup, ni ne se fige instantanément: tout le plaisir du texte émane de
cet effleurement léger et lent des
paysages, dans la diversification des focalisations et angles de vue du voyageur-narrateur.
Le paysage est perçu ou bien d’en haut (du haut d’une colline), ou bien d’en
bas (au pied de la montagne), suivant les mouvements de va-et-vient du
voyageur-cavalier, verticalement ou horizontalement, ou encore suivant le
rythme du bateau qui fait son entrée au port. D’explication en explication, le but du voyage se précise
lentement, suivant la cadence d’une narration qui frôle la réalité perçue,
propice à la réflexion bien posée et aux aveux mélancoliques qu’un voyage fait
à l’âge mûr. C’est pourquoi son récit se présente comme inclassable au niveau
générique, vu l’amalgame qu’y effectue l’auteur entre mémoires et écriture
autobiographique et le tout agencé dans une écriture fragmentaire qui n’obéit
nullement au souci d’authenticité tant requis par les voyageurs des lumières.
Hugo
et « le Rhin »
Par ailleurs, en
parlant du voyage imaginaire, rien ne serait, à notre sens, plus lacunaire que
de faire abstraction d’un texte hugolien certes malfamé mais d’une valeur
littéraire non dépourvue de tout intérêt. Il s’agit d’une liasse de textes
épistolaires suivi d’une longue réflexion littéraire sur La question du Rhin
que Victor Hugo a publié sous le titre « Le Rhin », où il
entendait emprunter au lecteur ses
lunettes pour qu’il puisse lui faire voir ce qu’il voyait :
«
Je tâche que ma lettre soit une sorte de fenêtre par laquelle vous puissiez
voir ce que je vois »
C’est un texte hybride à la fois au niveau générique comme au niveau
isotopique, compte tenu du fait que l’œuvre s’offre au lecteur comme une sorte
de bric-à-brac de récits hétérogènes, présentés sous forme de lettres de voyage
fictionnelles, auréolées de descriptions architecturales et où sont orchestrés
des thèmes qui ont trait à l’histoire et à la politique. Faudrait dire que
Victor Hugo entendait faire fondre en un seul texte qui ne tient pas compte de
la linéarité, comme c’est le cas pour Chateaubriand, trois voyages qu’il
prétend avoir effectué en compagnie de Juliette Drouet entre 1838 et 1840,
technique dont Nerval fera son miel au même titre qu’Hugo.
Dans le Rhin,
certes, les dates mises en exergue de chaque lettre donnent une caution de
véracité, mais, à voir clair dans l’intelligibilité du texte, nous constaterons
que la datation est manigancée, quoique Hugo ait affirmé que ces lettres ont
été écrites au jour le jour, mais nous remarquons que certaines lettres
fictionnelles y ont été incrustées par la suite. De même certains toponymes
donnent l’impression que Victor Hugo cite des lieux qu’il n’avait jamais
visités (comme le Musée de Wallraf en Cologne) mais dont il gardait une image
grâce à sa culture livresque, chose que nous allons retrouver chez Nerval. A
dire vrai, Hugo s’aventure parfois à aller jusqu’à réécrire des textes qu’il
avait lus quelque part et en reproduit le contenu comme s’ils étaient les
siens. Et Le Rhin se présente alors comme « un tissu nouveau de citations
révolues », s’il m’est permis d’emprunter cette citation à Roland Barthes.
Autrement dit, Le Rhin n’est au fond qu’un assemblage de plusieurs intertextes
dont il est pourtant difficile de déceler l’origine ou l’hypotexte. Vu le
janotisme qui enduit ce voyage dont on n’a pas pourtant des preuves
biographiques, nous pourrions dire que, d’un coté, le Rhin est un antivoyage ou
un pastiche du récit de voyage lamartinien, d’un autre coté, une invitation au
voyage à la manière de Baudelaire.
Si l’écriture
chateaubriandesque est une mise en examen de la culture livresque, l’écriture
hugolienne du voyage se distingue de la première par sa théâtralisation de
l’espace fortement accentuée par la lumière lunaire qui fait rêver le poète
dans l’ombre de la nuit épaisse. L’écrivain s’y assigne alors la tâche
d’exhumer tout un héritage médiéval oublié dans la pénombre des âges, à travers
un registre merveilleux où priment le nostalgique et le spectaculaire. Ainsi nombre de scènes créent de façon
fugitive l’illusion, l’inattendu, le merveilleux et le surnaturel. À ce stade,
le « vu » s’amalgame à l’imaginaire, mais celui-ci s’allie au « lu » plutôt
qu’au vécu. À son tour, le lu s’associe à la rêverie, et celle-ci passe à la pensée.
Ainsi Le Rhin s’apparente beaucoup plus au voyage littéraire qu’au voyage
autobiographique. D’un autre côté, le voyage hugolien relève plutôt du journal
d’une pensée que du journal de voyage fidèle à la description de l’itinéraire,
car Hugo, dans son voyage introspectif, se livre souvent à des épanchements.
Dès lors, le discours songeur et le discours rêveur y sont beaucoup plus présents
que celui du vécu personnel. Tout rempli de réflexions sur le passé à travers l’observation
des ruines, son voyage parvient à prévoir l’avenir, tandis que le présent se
trouve caché dans l’ombre.
Récit
hétérogène mêlant histoire, légende, conte, poésie, description, réflexion, exposé,
commentaire, Le Rhin est un récit de voyage aussi digressif que fragmentaire, non
seulement en raison des lettres successives, mais aussi à cause de
l’enchâssement d’innombrables récits seconds. Aussi en découle-t-il un aspect
rhapsodique avec la discontinuité et l’inachèvement, l’absence d’unité et la
composition très libre. Une multitude de digressions se présentent sous forme
de conte, légende, anecdote et chroniques. Par conséquent, la fusion de trois
voyages distincts, la datation fictive et une foule de récits imaginaires
intercalés nous permettent de considérer Le Rhin comme un voyage fictionnel :
il semble que le lecteur est guidé par le voyageur visionnaire à la recherche
de traces fragmentaires d’histoires et de légendes oubliées ou ensevelies.
Fantaisiste, solitaire et silencieux, le voyageur hugolien se déplace sans
contact direct avec la réalité locale, sa promenade n’étant guidée que par sa
fantaisie, sa curiosité et sa méditation. En excursion capricieuse et
improvisée, il se laisse aller au hasard et son itinéraire trace une ligne
courbe. C’est une errance, une déambulation, une flânerie de songeur. Selon la
formule “de la rêverie à la pensée”, le voyageur hugolien aime à déambuler à sa
guise :
« Je
suis un grand regardeur de toutes choses, rien de plus, mais je crois avoir
raison, toute chose contient une pensée, je tache d’extraire la pensée de
la chose. C’est une chimie comme une autre »
Nerval et le Voyage en Orient
Examinons, à présent, à la loupe le
Voyage en Orient de Gérard Labrunie. En effet, il ne serait nullement inutile,
ne serait-ce que pour vous mettre un peu dans le bain, de situer le texte par
rapport à son contexte d’émergence. Eh bien ! Ce texte, quoiqu’il produise
parfois l’impression d’être revêtu d’un aspect ésotérique, est doté d’un
intérêt testimonial primordial, dans la mesure où il instaure la doxa d’un
mythe orientaliste qui sera ressassé par la suite hypertextuellement par moult
homme de lettres. Or, Nerval, à l’encontre de la majorité écrasante de ses
prédécesseurs, fait preuve d’une estimable conscience culturelle en appelant à participer
à la restauration de l’héritage oriental, et de contribuer à cette archéologie
du savoir puisque la dernière partie de son récit comporte cet aveu :
« Dans le
Moyen Age, nous avons tout reçu de l’Orient ; maintenant nous voudrions
rapporter à cette source commune de l’humanité les puissances dont elle nous a
doués, pour faire grande de nouveau la mère universelle. »
D’ailleurs, la
genèse de ce texte est de caractère foncièrement fictionnel. Non pas que le
voyage soit un voyage fantastique à la manière d’un Defoe ou d’un Verne, mais
le récit qu’en fait l’auteur-voyageur est biscornu, dans le sens où il déjoue
la régularité des données spatio-temporelles, sans vous parler de la
description toponymique et des récits contiques qui interrompent la linéarité.
Publié en édition
intégrale dans les années 1851, Le Voyage en Orient est, à y voir de plus près,
un remaniement et une réécriture de petits fragments textuels antérieurement
publiés par Nerval dans des revues ou des journaux. Au niveau diégétique,
l’auteur y fait succéder deux voyages entre lesquels il y a un décalage de
plusieurs années, sans omettre l’insertion de quelques fragments de voyage
fictionnel (Surtout lorsqu’il parle de l’ile de Cythère en Grèce). En fait, les
lettres de Voyage suivies des amours de Vienne déjà publiées en feuilleton sont
reprises par l’écrivain en tête du récit, non sans quelques modifications. Si
l’auteur a opté pour le fusionnement de ses deux voyages en un seul texte,
c’est pour mieux les assortir l’un à l’autre, loin de toute considération
topologique ou chronologique. Entre les deux récits faits des deux voyages,
Nerval dresse un pont fictionnel d’un itinéraire imaginaire de Vienne à Syra
via Trieste et qui prend fin avec le récit irréel de la croisière aux iles
grecques.
A comparer le
voyage en Orient de Gérard de Nerval à l’itinéraire de Chateaubriand, se laisse
poindre à l’horizon une différence catégorique de premier degré. Si l’auteur
des Mémoires d’outre-tombe marque sur sa carte géographique de voyage les trois
villes dites des Martyrs : Rome, Athènes, Jérusalem, l’auteur des Chimères
brouille la tradition et opte pour trois villes intermédiaires tout en
intervertissant l’Ordre: Le Caire, Beyrouth,
Constantinople. A Rome, Nerval substituera Constantinople, capitale de
l’empire ottoman, à Athènes, Le Caire,
ville-témoin de l’âge d’or de la
science égyptienne, et enfin Beyrouth, avec
la proximité des Druses
et de leur prophète Hakem,
prendra la place de Jérusalem.
Non que ces
trois villes puissent aucunement
à ses yeux
remplacer les trois
villes traditionnelles de l'Occident, mais
y voyager c'est, à son sens, être capable
de déceler ce
qu'il y a de mensonger dans
l'énoncé que nous
proposent celles-ci.
Le voyage
de Chateaubriand reste
pour Nerval un
voyage de surface. Lui-même calcule
le sien en
utilisant des centres
annexes, foyers d'ellipses englobant les
principaux, qui lui
permettront de mettre
en évidence par
des parallaxes toute l'épaisseur
de piège que recèlent
ces centres normaux. Parcourant les
rues ou les
environs du Caire,
de Beyrouth ou de Constantinople, Nerval
est à l'affût
de tout ce
qui lui permet
de pressentir une caverne
s'étendant au-dessous de
Rome, Athènes et
Jérusalem. Laquelle est toujours
atteinte au détour
d'un récit, d'une
fiction; la seule descente véritable,
prélude d'ailleurs à un récit,
servant de métaphore
ou sacrement à toutes
les autres, est
celle de la
pyramide. La science de
la pyramide, la
sagesse maçonnique, se
présente comme fondation de
celle d'Athènes. La
passion de Hakem, le
séjour de Hakem dans
le maristan, l'hôpital des
fous, étant ici
l'équivalent du voyage souterrain, oppose une
autre incarnation à
celle du Christ
mort à Jérusalem.
Enfin, dans les
nuits du Ramadan,
le conteur nous
mène avec Adoniram dans
le monde souterrain où
non seulement l'empereur
Salomon, mais le
Jéhovah même dont il
tire sa puissance
si lourdement apparente,
se révèlent comme
des usurpateurs. Et comme les
trois villes de
Chateaubriand communiquent, Rome rassemblant avec
ses empereurs et
papes l'héritage, le
testament d'Athènes et de Jérusalem, mais
en les brouillant quelque
peu, de même les
cavernes de Nerval communiquent
les unes avec
les autres :
le messie des
Druses a vécu sa
passion au Caire, c'est
parce qu'il s'étend
sous Jérusalem que
le monde souterrain d'Adoniram
finit par miner
le sol de
Rome même. Certes, il
y avait bien dans
L'Itinéraire une présence
du souterrain, à cause
du thème fondamental
des tombeaux, mais
il suffit à l'un de
relever les monuments et
inscriptions, c'est-à-dire ce que l'on
a retenu du
mort au moment de son
ensevelissement, de sa
transformation en caractère,
tandis que l'autre veut
arracher aux morts
le secret de ce
que l'on n'a justement
pas voulu retenir. C'est
pourquoi Nerval est obligé
de découvrir des voies
obliques pour se faufiler
sous les dalles. Le
pèlerinage de Chateaubriand
est un voyage dans
l'histoire, celui de Gérard de
Nerval dans le
mensonge de l'histoire.


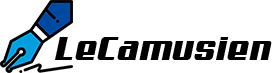

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire