La tragédie: Esquisse d'une définition
Que la tragédie ait acquis un statut éminent parmi les genres littéraires demeure un constat évident, vu non seulement son ancrage dans la grande Histoire depuis les stoïciens, mais encore en raison de l’impact décisif qu’elle a exercé sur les esprits au fil des siècles. Elle ne cesse, en effet, de gagner en popularité en ce sens qu’elle traverse constamment le quotidien de l’Homme. Nous serons tentés, à juste titre, de dire avec Ion Omesco que « la tragédie tourne autour de l’homme »[1]. Effectivement, la tragédie prend parti pour l'Homme. Elle plaide en faveur de l'humanité, et tend, ainsi, à faire de la condition humaine sa cause universelle. Certes, elle ne prétend nullement psychologiser l'homme, mais, elle s’assigne plutôt la tâche d’entremetteuse entre l'être et le monde grâce à son essence métaphysique que laissent poindre à l’horizon, lors de la mise en scène, plusieurs paramètres, y compris le mythe, la musique et, à plus forte raison, le chœur.
Ce serait trahir l’origine de la tragédie que de réduire la fonction primordiale du chœur des satyres à celle de medium. En tant que porte-parole de la vox populi et de l’au-delà, le chœur constitue l’essence même de la tragédie. Dans ce contexte, Nietzsche est en droit d’affirmer que « la tragédie est d’abord seulement chœur et non drame »[2]. Bien entendu, établir la distinction entre les deux notions de « chœur » et de « drame » nous conduira inéluctablement à recourir à la tradition antique. A juste titre, si nous admettons avec Aristote que la tragédie représente l’art le plus sublime après la musique, il serait judicieux d’ajouter que c’est parce qu’elle est issue d’une alliance entre Dionysos, le héros originel, et Apollon, le représentant du principe de l’individuation. Nul ne peut dénigrer, en effet, le fait que la tragédie gréco-romaine avait pour héros archétypal le dieu de l’ivresse et de l’inspiration et que les autres figures mythiques qui sont mises en scène par Eschyle, Sophocle ou encore Sénèque, dans leurs pièces sont à l’image de Dionysos. Si telle est la structure subreptice sur laquelle s’étaye la tragédie, c’est que, comme l’affirme judicieusement Nietzsche, « Le seul [être] véritablement réel, Dionysos, apparait sous une pluralité de figures »[3].
Somme toute, Dionysos est le spécimen du héros tragique. Rappelons-nous, à cet égard, que les orgies consacrées à Bacchus à Rome ou à Dionysos en Grèce étaient, en particulier, un hymne à l’ivresse, laquelle permettait aux hommes de se rapprocher du dieu de « Thumêlé ». Née très probablement au Vème siècle avant J-C du dithyrambe, la tragédie est aussi et surtout un chant panégyrique en l’honneur de Dionysos. A l’époque, un chœur d’hommes déguisés en boucs dansait autour d’un autel, table de sacrifice où l’on pose une offrande, souvent une jeune fille, belle et vierge.
Peu à peu, la tragédie deviendra réellement un spectacle où les « citoyens » viennent pour voir et apprendre, pour le plaisir et pour l’instruction. La catharsis a eu lieu. Nous en arguons que la tragédie a une double fonction : l’une esthétique, l’autre éthique. La première répond à la question du beau, esquissée par Platon dans Le Banquet ou encore La République. En tant qu’art sublime, la tragédie doit se présenter comme une mimesis de la nature humaine. Cette sublimité recherchée se matérialise généralement au niveau de la langue, de la nature des passions peintes, de la noblesse des personnages mis en scène, des thématiques choisies, etc. La seconde est souvent attachée à une morale qui est censée purifier l’individu en tenant bel et bien à susciter chez lui du pathétique et de la terreur. C’est ce que laisse entendre le chapitre VI de la Poétique où Aristote propose une définition concise et ciblée de la tragédie comme étant :
« L’imitation d’une action grave et complète, ayant une certaine étendue, présentée dans un langage rendu agréable et de telle sorte que chacune des parties qui le composent subsiste, séparément, se développant avec des personnages qui agissent, et non au moyen d’une narration, et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la même nature »[4].
Il convient, indispensablement, de nous arrêter sur cette acception qui foisonne de traits définitoires de la tragédie. Tout d’abord, la tragédie appartient, suivant la terminologie aristotélicienne, au paradigme des arts se basant sur la mimésis de la nature humaine, par opposition à la diégésis. La dichotomie mimésis / diégésis se redouble d’une autre antinomie, laquelle permet de discerner la tragédie de l’épopée. Si l’œuvre épique s’érige au fur et à mesure par le biais de la narration, l’œuvre tragique, en revanche, découle d’un ensemble d’actions qui s’enchevêtrent les unes aux autres afin de déboucher, en dernière instance, sur une action principale d’où la règle de l’unité d’action. Nonobstant ce, il est aisé de constater que dans certaines pièces eschyléennes, à savoir Prométhée enchaîné, l’action s’efface quasiment au profit de la mise en scène d’une fable d’essence mythique. Ici, il ne serait nullement futile de noter avec Nietzsche que c’est « dans la tragédie » que « le mythe acquiert […] sa portée la plus profonde, sa forme la plus expressive »[5].
Plus tard, nous verrons que la mort de la tragédie est concomitante de la perte du mythe de tout prestige et de toute consistance dans la littérature, et la renaissance de l’écriture tragique entraînera la régénération de la mythologie. L’histoire littéraire est là à le démontrer : L’ère gréco-romaine, le moyen âge allemand et espagnol et le grand siècle classique français sont considérés, par excellence, comme les âges d’or de la tragédie en tant que véritable laboratoire littéraire de la mythologie. L’avènement du christianisme justifie, à plus forte raison, le déclin de la tragédie, qui tendra, désormais, sous cette tentation, vers le Mystère. De même, au XVIIIème siècle, la philosophie des Lumières, poussée à bout, engendrera la récidive de la tragédie, en dépit des tentatives vaines de Voltaire, et, en échange, une autre forme de théâtre – Le drame bourgeois- verra le jour avec notamment Diderot et le Caron de Beaumarchais :
« Les deux grandes forces qui vont s’affronter à partir de la renaissance : la révélation chrétienne et la Raison philosophique, ont ensemble un ennemi commun : la tragédie, qui succombera sous cette double attaque »[6].
Certes, la tragédie, ayant perdu son assise mythologique, paraissait pendant ses époques de crise tel l’adversaire redoutable de la raison et de la foi, pourtant, elle subsistera quand même avec des intrigues tantôt à caractère hagiographique et biblique, tantôt à caractère historique voire légendaire. Ce n’est qu’au début du siècle classique que ressuscitera la tragédie telle qu’elle a été conçue par Aristote, avec des figures littéraires emblématiques, entre autres, Jean Rotrou, Pierre Corneille, et Jean Racine. Néanmoins, force nous est de signaler que les deux premiers dramaturges sont imprégnés beaucoup plus par l’esthétique baroque qui cultive l’éphémère, l’hétéroclite et le sentimental. D’ailleurs, chez Racine, comme chez Corneille et Rotrou, la passion entre en duel contre la raison, mais Chez le premier, la passion en sort souvent battue, tandis que chez les autres, ou bien c’est la raison qui en sort vaincue, ou bien les deux tendances sont réconciliées. Boileau, le théoricien de la doctrine classique, préconise, à cet égard, de prévaloir la raison au détriment de la passion:
«Et que l’amour, souvent de remords combattu Paraisse une faiblesse et non une vertu»[7]
Cette fascination exercée par la véhémence irrationnelle de la passion est au cœur du débat tragique au XVIIème siècle, dans la mesure où même lorsqu’il s’agit de pièces politiques, Iphigénie et Bérénice en guise d’exemple, Racine ne se focalise nullement sur l’étude Machiavélique des qualités du prince idéal. Au contraire, il ne traite que du déchaînement de la passion suscitée par un amour illicite. Ainsi, pour fuir l’affliction d’une passion irrassasiable, le héros se résigne à démanteler son bonheur (Phèdre, Hermione), puisque, à son sens, l’envahissement de la passion dépasse le drame sentimental : il souligne la fragilité de la nature humaine. Conformément aux conventions, Racine respecte la bienséance par le recours à une langue noble, cherche la sobriété de l’expression et se plaît à personnifier les abstraits. Toutefois, dans ses pièces les plus fameuses, la pureté du langage s’oppose diamétralement à la nature des passions qu’il s’escrime à peindre. S’il les présente souvent dans une rigueur classique saillante, c’est pour extérioriser son pessimisme radical à l’égard de l’homme et du monde. Et c’est dans la reprise des mythes antiques que « Racine retrouve le secret de l’émotion des Anciens : la représentation de l’homme accablé par son destin »[8].
Dans cette optique, la notion de destin est considérée, depuis belle lurette, comme l’un des critères déterminants d’une tragédie. Selon le mot de Domenach, « la tragédie consiste en l’affrontement de la liberté et de la fatalité »[9]. C’est ainsi en cherchant, coûte que coûte, à échapper à l’ascendant du destin, qui pèse sur lui, qu’Œdipe tombera dans l’iniquité. Le tragique découle, dans ce cas, d’un critérium : le héros est lacéré entre liberté et fatalité. Il croit agir suivant son intuition, mais, en même temps, il est manœuvré par des forces métaphysiques qui dépassent sa volonté. Chez Corneille, à titre d’exemple, ce conflit se traduit par un dilemme où le protagoniste est écartelé entre deux partis antithétiques présentant tous les deux des contrariétés.
Dans la plupart des cas, la souffrance humaine que la tragédie tente d’explorer est cernée dans la thématique de la liberté et de la fatalité. Plus souvent, celle-ci naît de l’hybris du héros tragique qui, en bafouant les lois prescrites par la divinité, cherche, vaille que vaille, à surpasser son sort. En guise d’exemple, Antigone, à l’instar de son père, vit dans la démesure de l’hybris, et c’est en défiant Créon qu’elle attise le courroux divin. Partant, la fatalité chez Antigone de Sophocle relève, en grande partie, d’un châtiment des dieux relativement à son hybris. A cela s’ajoute le fait que la fatalité qui accable le personnage d’Antigone est la conséquence de la faute qu’elle a héritée de son père Œdipe. De même, le flagrant délit dans lequel est tombée Phèdre paraît être corollaire, non seulement au dérèglement de son amour incestueux pour Hippolyte, mais aussi et surtout au fait qu’elle est issue de la lignée maudite de Minos et de Pasiphaé.
A l’encontre de l’opinion la plus commune qui fait de la tragédie une pièce à dénouement malheureux, nous ressentons l’obligation de signaler que ce critère purement formel -qui permet d’ailleurs de distinguer tragédie et comédie- n’est que la conséquence directe des diverses caractéristiques de la tragédie que nous venons de dénombrer. Il reste à ajouter, dans le même contexte, que dans une tragédie, « la mort n’y est qu’un prétexte ou une sanction »[10]. Cette remarque rejoint l’affirmation de Jean Racine dans sa préface à Bérénice où il estime qu’une mise en scène macabre n’a pas besoin d’éclabousser le sang pour susciter la peur chez le spectateur :
«Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie.»[11]
Pour Racine, un auteur tragique peut bel et bien se passer de la violence physique dans une pièce. Nul besoin de voir un personnage ramper et agoniser sur les planches, parce que ce serait quelque chose de beaucoup trop banal, alors que suggérer la mort d'un héros sans la montrer sur scène confère à ce dernier une empreinte divine, une sacralité et une spiritualité sans égale. Il devient un spectre théâtral qui obnubile l'esprit des coupables. Cette « tristesse majestueuse » accentue la nécessité d’encombrer les paroles des personnages d’une tonalité tragique pour qu’il y ait tragédie au sens strict du terme.
[1] Omesco Ion, La métamorphose de la tragédie, Paris, PUF, 1978, P. 29
[2] Nietzsche Fr., La Naissance de la tragédie (1872), Paris, trad. J. Marnold & J. Morland (1906), P. 85
[3] Ibid., P. 93
[4] Aristote, Poétique, Paris, Ladrange, trad. J. Barthélemy-Saint-Hilaire (1838), Ch. VI
[5] Nietzsche Fr., Op.cit., P. 96
[6] Domenach J-M., Le retour du tragique, Paris, Ed. du Seuil, Col. Points/essais, 1967, P. 56
[7] Boileau Nicolas, L’art poétique, Paris, Hachette, 2012, Chant III, Vers 100-101
[8] Ligny & Rousselot, La littérature française, Ed. Nathan, 2014, P.49
[9] Domenach J-M., Op.cit., P.32
[10] Domenach J-M., Op.cit., P. 53
[11] Racine Jean, préface à Bérénice, 1671, Gallimard, 1994, P. 4


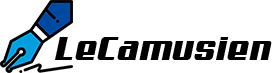

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire