La méthode psychanalytique est particulièrement précieuse, dans la
mesure où elle nous permet de mieux entendre les voix intérieures du poète et
de mieux saisir la mythologie personnelle Rimbaldienne. En fait, la mythologie,
au sens trop large du terme, se situe chez Rimbaud moins au niveau textuel ou
référentiel qu’au niveau de la perception et de la pensée. C’est dire que
le mythe personnel rimbaldien est porteur d’une symbolique difficile à déceler
mais qui a son assise dans la zone du subconscient. D’où l’importance cruciale
de l’approche psychanalytique dans la compréhension de sa poésie.
En fait, Rimbaud semble être né sous le
signe du feu. Le feu qui embrase, mais aussi le feu qui dévore et qui consume. Pourquoi
le feu justement ? Eh bien, parce que, comme le disait Bachelard, dans sa Psychanalyse
du feu : « Tout ce qui
change vite s’explique par le feu. Le feu est l’ultra-vivant. Le feu est intime
et il est universel. Il vit dans notre cœur. IL vit dans le ciel. IL monte des
profondeurs de la substance et s’offre comme un amour. Il redescend dans la
matière et se cache, latent, contenu comme la haine et la vengeance
[…] Parmi tous les phénomènes, il est vraiment le seul qui puisse recevoir
nettement les deux valorisations contraires : le Bien et le Mal. Il brille
au paradis. Il brûle à l’enfer. Il est douceur et torture. Il est cuisine et
apocalypse. »
Toujours dans
cette chasse spirituelle, il brûle les étapes –doctrines, systèmes et univers-,
il se brûle lui-même et, avant d’avoir vingt ans, consumé par le feu de
l’enfer, « roussi », et n’ayant découvert, en fait d’absolu, que sa
propre projection démesurée, il se retrouve les mains vides, « rendu au sol, avec la réalité rugueuse à étreindre ». N’est-ce pas là, dans un raccourci saisissant le drame même de
l’âme moderne ?
Car, pour
Rimbaud, il s’agit avant tout de faire table rase, d’immoler tout, de tout
salir : d’où un parti-pris de « crapule », un appétit de
malheur, de boue et de crime, une sorte de sadisme enfin.
Par ailleurs,
tout comme le feu, l’eau est l’image du devenir, image que Rimbaud se plaît à
conférer à ses poèmes :« L’eau est un type de destin, non pas
seulement le vain destin des images fuyantes, le vain destin d’un rêve qui ne
s’achève pas mais un destin essentiel qui métamorphose sans cesse l’essence de
l’être ».
Ainsi, l’univers des illuminations est
ainsi dominé par la hantise d’une apocalypse inondante, et l’imagination
rimbaldienne obsédée par une mythologie du Déluge.
Dans les
Illuminations, C’est l’eau, non le feu, qui est en bas, et c’est d’en bas
qu’elle part pour laver les souillures des choses et les vomissures des hommes,
pour occuper l’azur qui est du noir. La véritable rédemption n’est pas chez
Rimbaud une descente, elle ne se prépare pas par des génuflexions ou des
humiliations ; elle épouse au contraire le mouvement d’un surgissement
cosmique.
Il faut voir
dans les illuminations le dessin d’un drame plus cruel encore : le conflit
entre l’ange que Rimbaud aurait pu être et ce qu’il est réellement,
l’horrible travailleur rivé à sa tâche,
le grand criminel, le grand malade, le grand maudit. C’est le drame du moderne
de ne plus savoir reconnaître dans l’avenir les moyens de retrouver un paradis
perdu. Terrible péché d’orgueil, où l’on se veut Dieu, où l’on nie Dieu pour se
substituer à lui.
Catastrophe
cosmique, vision d’apocalypse en effet. Cette réalité « barbare »,
n’est plus que pluie de sang, un immense brasier. L’univers chavire dans
« le virement des gouffres et choc des glaçons aux astres ». Les
catégories de l’espace disparaissent, les éléments se confondent.
Vertige.
Alors que le
mythe de la naissance pénètre et dynamise tout l’univers des illuminations, il
n’est point, on le voit, de nativité possible dans l’enfer de Rimbaud. Et tout
le malheur du damné tient à cette stérilité, à cette solitude, à cette
séparation d’avec les choses qui le vouent à un soliloque tragique et sans
issue.
Dans la Saison
aussi, le feu « se révèle avec son damné » : mais c’est
alors un surgissement démoniaque. Car tout comme l’eau baigne les illuminations
de sa puissance fécondante, le feu étend sur la Saison un désert d’aridité et de souffrance. Feu
négatif, destructeur, rêvé dans ses effets plutôt que dans son origine, pouvoir
véritablement infernal qui finit par épuiser toute matière et par provoquer
parallèlement dans l’esprit un vide, une absence, « un sommeil bien
ivre sur la grève ».
Le rythme de la
Saison en enfer est celui d’un trépignement immobile, d’une frénésie
ressassante et toujours en lutte contre elle-même. Rimbaud y a la démarche d’un
animal harcelé : « Au dernier moment, j’attaquerai à droite et à
gauche. » Si règnent ici contestation et déchirure, c’est que la
recherche de soi s’y est à l’excès intériorisée, moralisée.
Une Saison en enfer réussit alors à être le
tragique poème de l’absence : absence des autres, absence des
choses, absence de soi. La vraie vie y est pathétiquement absente alors
qu’elle est ou plutôt qu’elle devient si merveilleusement présente dans chacune
des illuminations. C’est que le feu est passé par là, qu’il a tout consumé.
L’enfer rimbaldien, ce n’est peut-être qu’un vide sensible, une terre
brûlée.
A partir d’un feu central dont l’imagination rejoint étrangement
celle d’une sorte de sacrifice, de supplice volcanique de la terre, à partir du
« cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous »,
jaillissent dans Barbare des brasiers de diamants.
Dans Solde, Rimbaud chante « les
richesses jaillissant à chaque démarche. Solde de diamants sans
contrôle ! » Mais plus souvent encore que la terre enflammée,
c’est la terre liquide qui semble porter en elle et enfanter les pierres. On
voit les pierres précieuses apparaître à la surface du sol le lendemain d’une
pluie ou d’un déluge, dans une boue encore humide, ou bien elles pointent hors
de la terre pour le premier dégel du printemps, dans la mollesse d’un sol
fondu.
En gros, Rimbaud
cherche à retrouver la quintessence de l’univers. Pour cela, Rimbaud pourra
utiliser diverses formes liantes : celles que lui proposent le
ruissellement des liquides ou la vaporisation des herbes. Une certaine
perméabilité cosmique corrige en effet la discontinuité barbare :
l’arc-en-ciel symbolise cette réunion spongieuse de l’univers.
D’ailleurs,
il donne une merveilleuse définition de la vie changée et réunie à elle-même,
« de cette vie éternelle, non écrite, non chanté, - quelque chose comme la
Providence « les lois du monde un » que Rimbaud évoque dans
L’Alchimie : L’éternité/ c’est la mer mêlée/ Au soleil. L’union des deux
principes, eau et feu, ne se sépare pas du mouvement qui les attire l’un avec
l’autre vers un autre espace et vers un autre temps, vers une nouvelle
substance, une eau de feu. »
Quand Rimbaud évoque dans Barbare la « soie des mers
arctiques », il imagine de même une tendresse épidermique de l’eau, une
surface doucement vivante et chargée de faire éclore en elle toute l’ombre
immobile de grands fonds ; il rêve à une mer-gazon.


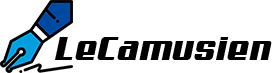
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire