Le Maroc, au cours de son histoire, et vu sa géographie entre
autres, a stimulé la curiosité de plusieurs voyageurs de statuts divers
(ambassadeurs, consuls, officiers, soldats, explorateurs, commerçants,
fonctionnaires, hommes de lettres, artistes, etc.), dans le passé, avant même
l’instauration du Protectorat, aussi bien qu’après son indépendance. Or, ce
Maroc, au singulier, s’est vu et se voit toujours encore soumis à un regard
pluriel, selon le contexte historique dans lequel le voyage a eu lieu et selon
les mobiles qui ont motivé le déplacement. Vu sous cet angle, le Maroc auquel
nous avons affaire est plus un Maroc rêvé, imaginé qu’un Maroc réel. Le Maroc est entré dans l’imaginaire littéraire français depuis le
XVIèmesiècle, à partir des récits d’ambassade, des récits de
captivité ou de rédemption.
·
Au Maroc de
Pierre Loti
Pierre Loti, voyageur cosmopolite,
n’a pas pu, à vrai dire, céder à cette tentation dont toute la tradition
occidentale fut obnubilée depuis la pénombre des âges, à la merci d’un
imaginaire érigé sur la base d’une stéréotypie peu ou prou tangible,
certainement discutable, à coup sûr infrangible. Il s’avère, à la lecture
avérée de ses récits de voyage, qu’il ne sillonne un espace lointain qu’en se
nantissant et qu’en se munissant de tout un arsenal d’images préconçues,
préétablies et escomptées sous le lumignon trop indécis d’une culture reçue
enduite d’escobarderies, de faussetés et d’artifices. D’emblée, dans les récits
de voyage lotiens, au voyage effectif précède un voyage fictif. Au voyage
livresque suit le voyage factuel. Rien d’étonnant à le voir ainsi rédiger un
récit d’une ampleur et une envergure ma foi non négligeables sur un voyage dont
la durée est pourtant brève. A voir clair dans l’intelligibilité du texte, nous
nous rendrons compte que les bribes du récit voient, d’ores et déjà, leur
genèse et se construisent non au fur et à mesure que soit effectué le
déplacement mais bien avant que le voyage n’ait lieu, non à dos de chameau ou à
bord du bateau, mais bien devant la cheminée, sur un fauteuil.
Pour ne pas nous y appesantir, allons
droit au vif du sujet. Il importe, à notre sens, de souligner que Loti ne
prend, à tort ou à raison, nullement la peine d’interroger les stéréotypes qui
siègent dans la culture qu’il a reçue soit à travers ses lectures ou bien à
travers ce qu’on lui a inculqué comme principes culturels durant sa vie
juvénile. Au lieu de tenter de se fondre et de s’immiscer au peuple marocain
pour comprendre le fonctionnement de sa culture, il s’accommode et se borne à
scruter du coin de l’œil, banalement et tout curieusement, les apparences en
s’efforçant de les justifier ou disant mieux de les accoler à ce bagage de
préjugés dont il fut chargé bien avant qu’il ne mette son pied sur le
territoire marocain, c’est-à-dire en essayant de dénicher dans le stock des
images dont son imaginaire fut meublé ou peuplé au préalable ce qui pourrait
justifier la misère de la plèbe, la barbarie de « ces berbères
indomptés », l’hypocrisie de « ces musulmans sans
conviction » et le fanatisme des « Derkaouas qui détournent la
tête et crachent à la vue d’un chrétien ».
Voyons avec quelle outrecuidance et
fausse certitude, les images du marocain, dans sa pluralité identitaire,
sont-elles construites et échafaudées sur le podium de certains mécanismes
réducteurs et simplificateurs. En effet, dans son essai intitulé « Les
identités meurtrières », Amin Maalouf affirme, à juste
titre :
« Par
facilité, nous englobons les gens les plus différents sous le même vocable, par
facilité aussi nous leur attribuons des crimes, des actes collectifs, des
opinions collectives : Les Serbes ont massacré, les anglais ont saccagé,
les juifs ont confisqué, les noirs ont incendié, les arabes refusent »
Telle semble être la vision de Pierre
Loti, vision réductrice, cataloguante, généralisante, s’efforçant, à tout prix,
à faire passer le marocain au crible d’un processus de catégorisation et de démonstration
par induction, déduction ou abduction. Certes, pour être fidèle au texte, dans
Au Maroc, l’image du marocain est conçue dans son hétérogénéité singulière,
mais sous l’angle d’un exotisme très palpable à travers les procédés textuels
utilisés d’une manière massive, à savoir, la description picaresque et
l’adjectivation par attribution. La narration, quant à elle, est véhiculaire
d’une trame d’événements qui s’organisent généralement autour d’une situation
conflictuelle entre quelques tribus et le Makhzen représenté par la personne du
sultan, elle aussi objet de descriptions exogènes.
Par ailleurs, toutes les actions des
Zemours sont décrites comme étant « paillardes et dangereuses ». C’est
pourquoi, les caïds et les pachas se mobilisent pour former des troupes afin
d’éteindre les rébellions qu’attisent les Zemours, « Ces terribles
Zemours, fanatiques, intransigeants, pillards, coupeurs de têtes, et, depuis
plusieurs années en rébellion ouverte contre le gouvernement de Fez ». Pierre
Loti tente, par ces images dépréciatives, de mettre le voyageur occidental en
garde contre le danger qu’il encourrait éventuellement en s’aventurant à
traverser les zones où règnent les rebelles. Cependant, l’auteur ne se prononce
pas sur les raisons qui ont poussé ces tribus à protester contre le pouvoir, ni
encore sur l’anarchie qui en était la conséquence ? Il se contente
seulement et uniquement d’énoncer pêle-mêle des préjugés sans fondement, pour
combler l’ignorance qu’il a des faits réels.
Dans le même sens, à décrire la
mesquinerie et l’atmosphère abjecte dans lesquelles la populace s’enlise
quotidiennement, l’auteur-voyageur s’ingénie à dresser un portrait polémique et
contestable du marocain en l’animalisant, en le zoomorphisant et en le réduisant
davantage à sa bestialité, par le biais de rapprochements stylistiques où
l’homme marocain est subsumé à son animal de compagnie :
« Il y a des
quantités d’enfants sur des ânons, quelquefois deux ou trois sur le même, en
brochette comique, il y a des vieillards à béquilles, des éclopés, qui courent
tout de même, des mendiants, des idiots, des saints illuminés qui
chantent ».
Voyons comment la description
se fait farcesque, voyons comment le peuple marocain est-il tourné en dérision,
comment le quotidien du marocain d’alors est-il peint sur un ton railleur. A y
voir de plus près, nous constaterons que l’exogène prend chez Loti l’ampleur de
la pure réalité. C’est pourquoi, il comble l’ignorance qu’il ressent envers les
spécificités culturelles du Maroc par un replâtrage de préjugés peu véridiques.
Ça se voit clairement dans son interprétation des fléaux de famine qui frappent
certaines tribus, interprétation médiocre et imbue de préjugés. A aucun moment,
Loti ne s’interroge sur la tyrannie de la classe dominante qui appauvrit les
paysans en les démunissant de toutes les provisions qu’ils ont l’habitude
d’emmagasiner dans des silos, des sortes de fosses souterraines. Bref, faute de
disposer d’un savoir ethnologique et historique objectif, Loti se plaît à
effectuer des faux-fuyants, des détournements comiques et des atermoiements
attestant de sa subjectivité poussée jusqu’à ses confins les plus
extrêmes.
En somme, il convient de signaler
qu’Au Maroc de Pierre Loti est d’une valeur testimoniale non dépourvue
de toute importance, dans la mesure où il témoigne de l’origine de certaines
données historiques qui ont frayé le chemin à la France pour accomplir son
entreprise colonisatrice, avec notamment le général Lyautey. Aussi, est-il
utile de souligner que certains préjugés véhiculés par le récit de Loti seront
par la suite systématisés en stéréotypes pour glisser enfin spontanément dans
l’imaginaire occidental et français en particulier. Il faut voir également dans
Loti le prophète qui insufflerait à la génération future de voyageurs français
certaines images toutes faites, images que certains s’arrogent librement et
naïvement, et que d’autres s’approprient avec réserve.
·
Sur la frontière marocaine de Capitaine Guillaume
En rédigeant ce
récit, Capitaine Guillaume entendait retranscrire noir sur blanc son expérience
viatique sur la frontière marocaine. Le sous-titre mis entre parenthèses est,
dans ce sens, très révélateur de l’intention de l’auteur-voyageur d’exhumer les
souvenirs qu’il gardait encore de son séjour missionnaire sur les
frontières nordiques maroco-algériennes. Qui dit souvenir, dit aussi une
aventure mnésique que le voyageur effectue en plongeant dans les réminiscences
et les images qui se sont gravées dans sa mémoire lors de son voyage. Ce qui
implique, au niveau référentiel, le risque de trahir la vérité nue à cause
d’éventuels trous de mémoire, et au niveau littéraire, le recours à la
narration, technique indispensable pour relater des événements ayant eu lieu
dans le passé, à travers notamment l’usage des temps du récit au détriment des
temps du discours. Pourtant, dans le présent récit, les pistes sont en quelque
sorte brouillées, d’autant plus que, d’amont en aval de la structure textuelle,
le présent est massivement de mise. Chose qui ne va pas sans apostropher le
lecteur qui se trouve dès lors ramené au présent, mais s’agit-il d’un présent
de narration ou bien d’un présent d’énonciation ? En d’autres termes,
s’agit-il d’une volonté de l’auteur de réactualiser les souvenirs dont il
entend justement rendre compte, ou bien, au contraire, un tel procédé insinue
que le récit a été écrit au fur et à mesure, c’est-à-dire à la manière du
journal, comme le laissent entendre les dates mises en exergue des
chapitres ? (P. 17 )
Le récit
s’ouvre sur une donnée officielle où le 1er Bataillon duquel faisait
partie Capitaine Guillaume fut désigné pour assurer la surveillance sur la
frontière marocaine et la félicité ainsi que la joie avec lesquelles cette
nouvelle fut accueillie. Ceci montre que cette nouvelle fut pour les troupes
françaises qui bivouaquaient alors sur le territoire algérien, territoire
d’ailleurs décrit d’une manière dépréciative, comme une sorte de panacée
salvatrice, dans la mesure où ceci semble sauver ces troupes-ci de la
désillusion et de l’atmosphère infernale où ils vivaient depuis un an à
l’Ouarsenis, village décrit comme étant terrible et meurtrier. Force nous est
de mentionner que dès l’incipit, le narrateur fait allusion à la misère où
s’enlisaient les petits colons, qualifiés de pauvres, d’impaludés, de mornes,
et de faces cadavéreuses. Grosso modo, dès la phrase-seuil, nous entrons de
plein pied dans une sphère faite de descriptions dévalorisantes avec une
idéalisation plus ou moins sidérante d’un Maroc qui, en comparaison à une
Algérie empestée, paraît comme un espace beaucoup plus favorable pour ne pas
dire utopique.
Cependant,
à peine le lecteur est-il mis au courant de la nouvelle en raison de laquelle
le 1er Bataillon s’est déplacé vers la frontière marocaine sur le
mode de l’énonciation, d’où la présence du déictique Maintenant et de la
1ème personne du pluriel « nous » comme sujet
d’énonciation renvoyant au narrateur et ses coéquipiers, eh bien à peine le
lecteur est-il mis au courant de cette nouvelle, le narrateur effectue une
analepse vers le passé, précisément trois ans avant, en recourant au procédé de
la mise en abyme, à travers notamment le recours à l’imparfait et au
plus-que-parfait, comme temps du récit. Dans ce très court récit sur lequel se
clôt le premier chapitre, nous constatons avec quelle fascination sont décrits
des événements de tension entre le rogui et l’altesse chérifienne qui, au dire
de l’auteur, lui sont restés étrangement chers. Force nous est de
signaler, en fin de compte, que le va-et-vient entre récit et discours, entre
narration et énonciation, entre histoire et réflexion, très caractéristique de
la Relation de voyage comme nous l’avons déjà montré au tout début de notre
intervention, se présente comme problématique, d’autant plus que les frontières
entre les deux s’avèrent parfois intraçables.
Certes, ici,
il ne nous est guère permis de procéder à une analyse linéaire du texte, mais,
il importe tout de même, à notre sens, de nous y arrêter, pour pouvoir se
mettre dans le bain. En effet, le second chapitre commence avec le campement
des troupes françaises sur la frontière marocaine, plus précisément à
Sidi-Boudjenan. L’ellipse effectuée par le narrateur couvre un intervalle de
temps d’un mois, ce qui est explicité par la date mise en exergue par le
narrateur. On est en Octobre. A l’atmosphère fétide, lourde et fade du premier
chapitre, le narrateur oppose une atmosphère imbue de suavité, de clarté et de
scintillement. Cependant, à cette description appréciative viendrait vite
s’achopper une dévalorisation de la langue arabe, décrite comme étant une langue
ferme, raide, gutturale, comminatoire, à tel point que tout mot proféré par
arabe laisse l’impression que la personne en question est entrain d’éjecter des
injures. Une telle analogie ne reflète qu’une vision égocentrique, car, le
narrateur n’énonce un tel jugement de valeur sur la langue arabe qu’en la
comparant à sa propre langue, sans tenter d’aller au-delà de la phonétique pour
faire découvrir au lecteur ce qui fait la différence, la beauté et la richesse
de chacune des deux langues. Mais, à notre grande surprise, l’auteur, en
rédigeant son texte, use de certains mots qu’il emprunte à la langue arabe,
comme, par exemple, araba, oued, derboukas, el baroud
Un peu
plus loin, le narrateur relate comment sa troupe s’est déplacée entre les
montagnes sur la frontière et les péripéties qui s’en suivent, mais non sans
alluder, à chaque fois, à ce mystère
dont est enduite sa vision du Maroc, (Les profondeurs mystérieuses de la plaine
marocaine) d’un Maroc qui ne lui est ni connu, ni non plus totalement inconnu,
à supposer qu’il en a une connaissance si minime soit-elle, ne serait-ce qu’à
travers cet imaginaire qu’il s’est construit de ce Maroc soit par le biais de
ses lectures ou de ses fréquentations et confrontations au monde maghrébin. Chemin
faisant, le narrateur peint, avec une verve descriptive intarissable, les
paysages pastoraux splendides que la vue lui permet de savourer de loin, même
si à un moment donné, il intervient, mais alors d’une manière latente, pour
mettre en relief la paresse du peuple marocain, très connu comme stéréotype
encore vivant de nos jours dans l’imaginaire occidental, et ce en alludant à la
fertilité des terres qu’il a parcourues quoiqu’elles ne sont pas cultivées.
Pourtant, à
l’encontre de Loti qui, en bon épigone des romantiques, essaie de s’arroger
l’espace pour exalter le moi, Guillaume se garde, dans certaines mesures, de
tisser une relation proprioceptive entre le sujet percevant qu’il est et
l’objet perçu dans son autonomie. Ceci ne veut en aucun cas dire que la
description chez Guillaume se neutralise jusqu’à passer pour le regard d’un
ethnologue, mais ceci veut dire que le narrateur ne s’investisse pas autant que
le faisait un Loti dans ce qu’il voit. Autrement dit, chez Guillaume, c’est la
perception extéroceptive qui prime au détriment de la perception intéroceptive,
pour utiliser une terminologie proprement sémiotique. Mais à voir clair dans le
texte, nous remarquerons que ce n’est pas la règle chez Capitaine Guillaume,
puisque parfois, il tergiverse et se laisse plonger, sans indécision, dans
l’exotisme, surtout quand il décrit la danse bizarre de certains
indigènes qui l’ont accompagné pendant sa mission sur la frontière, mais non
sans manifester parfois sa fascination pour tel ou tel chant qui exalte la
nature, la femme aimée,..
Quelques pages plus
loin, en mettant son pied dans l’une des tribus qui se situe sur les zones
frontalières, le narrateur affiche sa grande déception quant à la manière de
vivre de ces campagnards, car, en quittant l’Algérie, il s’attendait à ce qu’il
rencontre des peuples qui ne sont pas de la même veine. Mais c’est toujours
l’image de femmes sales, d’enfants nus, de chiens hargneux, qui se fait
récurrente dans les deux cas. A
l’occasion, en parlant des femmes, eh bien, chez Capitaine Guillaume, la
description des femmes prend une telle envergure qu’il semble impossible de
l’extirper de son imaginaire littéraire. Dans un fragment très intéressant,
toujours dans les premières phrases, la mise en scène du quotidien de la femme
marocaine s’accompagne d’une métaphore filée qui met en valeur la sensualité et
la gaité avec lesquelles ces femmes accomplissent leurs activités journalières.
Ce qui sera confirmé par cette phrase « Les femmes arabes, qui ont
certainement la dose de sensibilité inhérente à leur sexe »
Cette vision
s’enracine, à dire vrai, dans tout un imaginaire occidental ayant, depuis belle
lurette, conçu avec une curiosité difficile à étancher le Harem du sultan en
images qui ne passent pas toujours pour authentiques. Un peu plus loin, le
voyageur dresse un portrait dévalorisant, de vieilles femmes, tatouées et
repoussantes, portrait auquel il oppose dans le même paragraphe une description
physique favorable de jeunes femmes, aux yeux brillants, aux dents blanches… Au
niveau du portrait moral, l’on voit substituer à cette description avantageuse de
la beauté et de la sensualité des femmes marocaines, des traits moraux virils
où elles passent pour des barbares, des diablesses mutilantes, infligeant aux
captifs des peines insoutenables. De manière générale, la cruauté des arabes
est avancée comme une pure réalité à laquelle les colons ne peuvent répondre
que par des représailles, d’où cette vision mystificatrice des colonisateurs
qui se veulent les ambassadeurs de la civilisation. A la fin de cette
réflexion, le voyageur en vient à conclure que la devise qui fait de l’Afrique
un purgatoire des ânes et un enfer pour les femmes est factuelle, justifiant
ceci par le fait que la femme dans cette contrée est reléguée au rang des
domestiques qui vivent sous le joug des hommes dans une société patriarcale par
excellence où le mot est à l’homme. Dans les derniers chapitres, Capitaine
Guillaume s’apitoie sur le sort des femmes :
« Le sort de la femme arabe est vraiment
pitoyable : On n'exagère rien en le comparant à un esclavage. Petite fille,
elle est vendue au premier venu, qui l'abandonne à son gré en payant redevance
aux parents. Au logis, elle n'est qu'un objet de luxe, soigneusement Dérobé aux
regards, ou bien une vile servante »
Il est vrai que
dans ce qu’il dit, une nuance de vérité est remarquable. Ajoutons à ceci un
point sur lequel le voyageur se montre vigilant et que l’on peut
considérer comme un atout, et qui n’est autre que celui où il se rattrape en
rappelant qu’il en est ainsi encore dans des campagnes françaises.


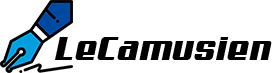
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire