A
soulever la question du statut de l’écrivain francophone, nous saute aussitôt
aux yeux, du même coup, la question de la praxis de l’écriture en langue
seconde, en tant que langue véhiculaire, par opposition à langue vernaculaire.
Rien ne se révèle, dès lors, assez ardu que de se livrer à tracer une ligne de
démarcation entre littérature française et littératures francophones, tant il
est vrai que l’écriture francophone, née sous le signe d’un mouvement
centripète, tend, à partir de la postmodernité, à refluer vers l’horizon où
elle s’abreuvait, en fonction d’un mouvement centrifuge. A y voir de plus près,
la pratique de l’expression en langue seconde s’avère, sinon périlleuse, du
moins contraignante, à coup sûr dilemmatique, en ce sens qu’elle astreint le
sujet-écrivant, d’une part, à se subjuguer à la nécessité d’élaguer ou de
dénoyauter cette langue dans laquelle il écrit de sa charge culturelle pour y greffer
la culture dont participe sa pensée, et d’autre part, à cibler un lectorat
universel sans récuser son identité culturelle autochtone. Bien entendu, « dans le panorama actuel du monde », c’est sous le signe de cette double contrainte que se pose pour
l’écrivain francophone, la grande interrogation glissantienne : «Comment être soi-même sans se fermer à l’autre et comment s’ouvrir
à l’autre sans se perdre soi-même ? ».
Y
répondre ad rem, ce serait défaire toute l’Histoire de la francophonie.
Sans nul doute, toute écriture francophone, de par sa nature hétérogène même, se
laisse configurer par un parallélisme où se confrontent et se réfléchissent les
uns dans les autres les imaginaires dont participent, tour à tour, et la langue
dans laquelle est pensé tout énoncé francophone, et la langue dans laquelle il
est couché sur du papier. Partant, faute de pouvoir écrire en langues locales
qu'ils maîtrisent mal et qui n’ont pas encore acquis une légitimité sur la
scène littéraire, certains écrivains africains, par exemple, s’attèlent à écrire
dans un français « africanisé », passé à la moulinette, dans une langue « volée », selon le mot
d'un vieux héraut, le Malgache Jacques Rabemananjara, une langue « violée », «violentée », « cocufiée » comme dirait, à son tour, le Congolais Sony Labou Tansi, avec la
conscience qu'il faut aller à « la rencontre de l'autre », en gardant
sa propre opacité, au risque de se perdre et de s’acculturer. L'Antillais de
stature mondiale Aimé Césaire a eu beau jeu de souligner dans ce sens qu’« il y a deux manières de se perdre : la dilution dans l'universel
et l'enfermement dans les particularismes ».
A y voir clair, il s’avère que
l’idée que nous a léguée Benveniste sur la propriété inhérente à toute langue
de charrier avec elle, comme la tortue sa propre carapace, tout le faix
culturel dont l’ensemble des locuteurs natifs l’ont chargée, est, toutes
proportions gardées, tombée en désuétude. La raison en est que, dans l’âge de
la complexité où nous vivons d’ores et déjà, pour parler comme Morin, les
langues, du moins celles de l’ancien colon, se trouvent en état de
dégénérescence. N’est-ce pas là la même idée que Derrida -qui avançait,
d’ailleurs, la thèse d’une inflation du signe- voulait insinuer en décrivant sa
relation avec la langue comme un jeu érotique de possession-dépossession
instantané, image qui ne va pas sans rappeler le Maghreb Pluriel de Khatibi :
«Ce qui ne me quitte pas
ainsi, la langue, c’est ainsi en réalité, en nécessité, ce qui ne cesse de se
départir de moi. La langue ne va qu’à partir de moi. Elle est aussi ce dont je
pars, me pare et me sépare. Ce qui se sépare de moi en partant de moi. »
A
juste titre, l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, entre autres, disait de son
roman Les Soleils des indépendances : « ce livre s’adresse à l’africain, je l’ai pensé en malinké et
écrit en français.». Dans ces conditions, écrire en une langue seconde, c'est souvent
penser dans une langue et écrire dans une autre, de manière à ce que se réalise
le rêve glissantien d’une poétique de la Relation, laquelle poétique « requiert toutes les langues du monde, non pas les connaître,
ni les méditer, mais savoir éprouver qu’elles existent avec nécessité. Que
cette existence décide des accents de toute écriture francophone.». C’est le cas au Liban, par exemple, où la génération postmoderne,
boursouflée par l’enflure des guerres civiles et religieuses, a pris conscience
de la nécessité de briser les barrières qui la schizent de l’universel, comme
l’a confié à Gilbert Pilleul, l’écrivaine Vénus-Khoury : « J'aime cette coopération entre les langues mais j'ai
l'impression, lorsque j'écris en français [...], que je suis en train de faire
bouger les cloisons, d'élargir l'espace de la langue française pour y placer
les phrases amples et larges de l'arabe ».
En
somme, avec la floraison de l’écriture francophone, la tradition monolingue des
discours ataviques cède, petit à petit, le pas à un dialogisme où se laisse
saisir le Différend dans ses ramifications rhizomatiques.
D’emblée, le statut linguistique
labile de toute écriture francophone offre, mieux que tout autre, la
possibilité de rendre tangible dans le texte littéraire cette poétique de la
Relation, par ceci même que «la
surconscience linguistique de l’écrivain francophone est-elle, avant tout, une
conscience de la langue comme d’un vaste laboratoire de possibles, comme d’une
chaîne infinie de variantes». Désormais, la littérature francophone est à repenser dans sa
propension à loger, à combiner et à tresser des rapports rhizomatiques entre
plusieurs langues. La littérature maghrébine postmoderne, pour sa part, est le
fruit d’un langage qui bifurque, voire trifurque, à travers les langues du
Maghreb, à savoir le berbère et l’arabe, langues nationales, et le français,
butin d’une guerre autant militaire que culturelle dont les séquelles ne font
que déchiqueter davantage l’âme d’un colonisé qui se cherche et qui cherche, à
toutes griffes, à se décoloniser, dans un mouvement où sont invoquées, dans les
délires de l’anamnësis, toutes les langues en «un point focal, un lieu de mystère où, se rencontrant, elles se
« comprennent » enfin. ». En guise d’exemple, au même titre que son homologue tunisien
Meddeb, Khatibi se veut en rupture totale avec la pensée dialectique qui aborde
la problématique du « Moi » et de « L’Autre », en termes de
dualisme, de clivage et d’exclusivité, au nom d’une « double critique » et
d’une « pensée autre »
très proche de ce que Glissant appelle « La
pensée archipélique » qu’il définit,
par ailleurs, comme « une
autre forme de pensée […] non-systématique […] accordée au chaos-monde ». C’est ainsi, dans « l’espace
détatoué » du « vrai-chaos », que se
construit en « une
infinité de jeux», l’identité
du décolonisé, prise dans le paradigme d’un «devenir»
inaltérable : « Nous sommes à
chaque seconde autres. Nous ne cessons de renaître», dira plus lucidement Meddeb.


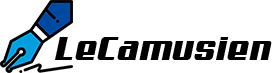
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire